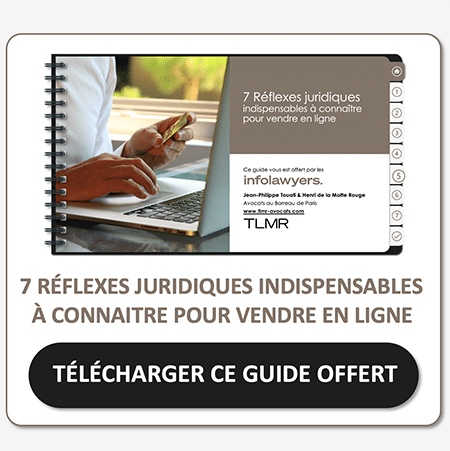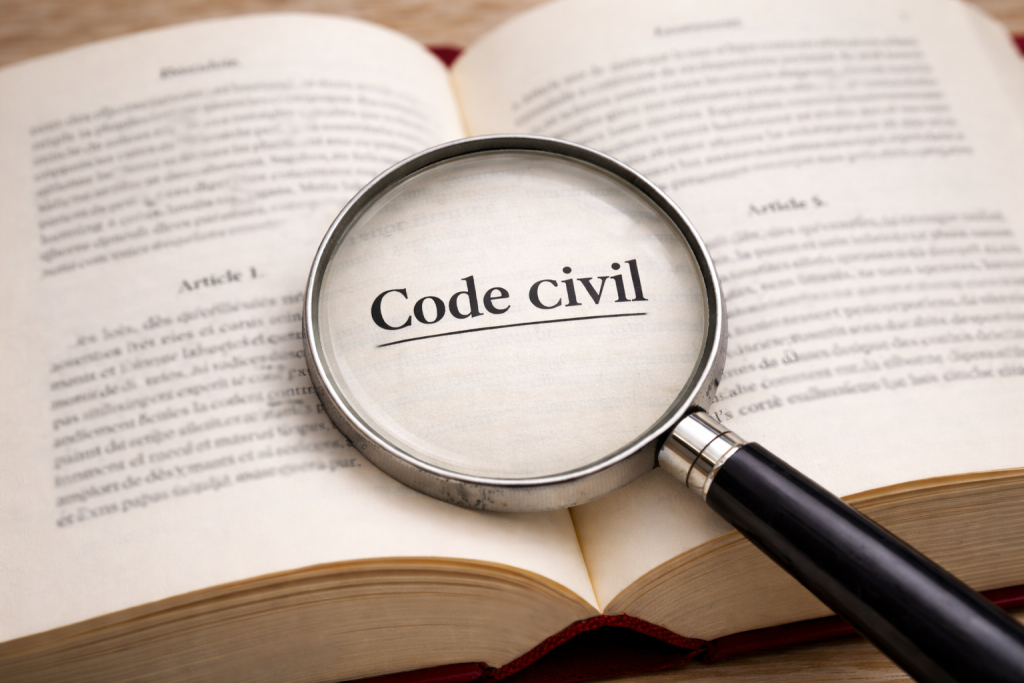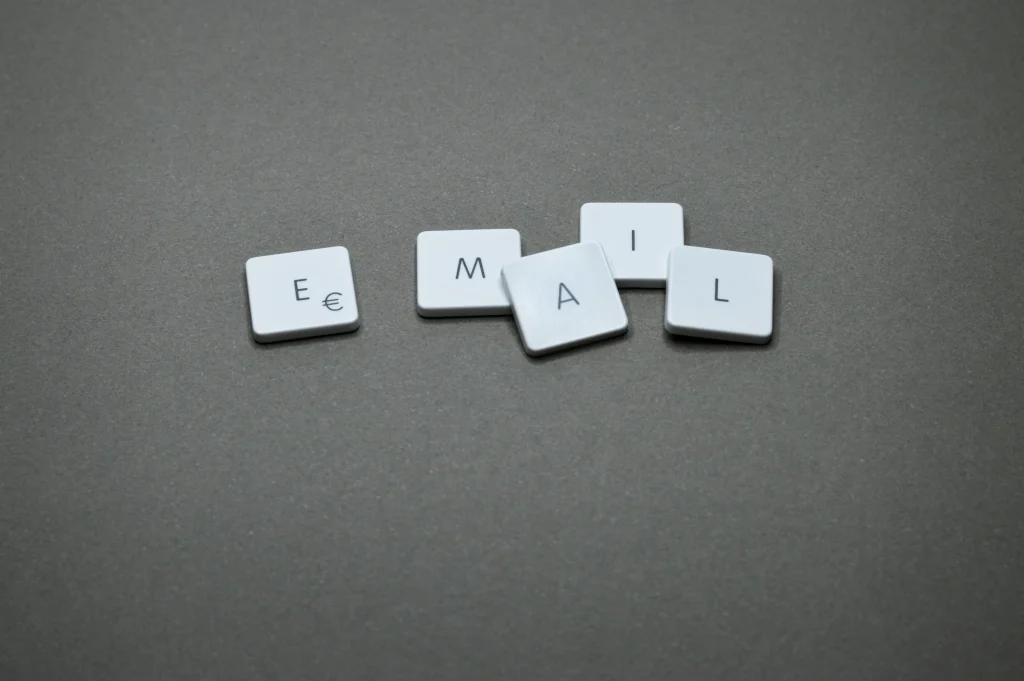Votre marque est l’un des piliers de votre activité en ligne. C’est elle qui capte l’attention des internautes, inspire confiance, génère des clics, fidélise votre clientèle et soutient le taux de conversion de votre site de vente. Mais dans l’univers numérique, les menaces sont nombreuses : signe déjà déposé, nom de domaine en conflit, usage abusif en SEO/SEA, contrefaçons sur les marketplaces ou en dropshipping. Face à ces risques, ignorer la dimension juridique fragilise l’ensemble de votre projet web. Dans ce guide pratique, les avocats d’Infolawyers reviennent en détail sur les principaux risques juridiques liés au duo marque et e-commerce. Nous vous proposons également les bonnes pratiques à mettre en place pour protéger votre image et sécuriser votre activité.
Marque et e-commerce : quelques rappels essentiels
Avant d’entrer dans le détail, revenons sur quelques points clés afin de bien comprendre le lien entre votre marque et votre activité d’e-commerce.
Qu’est-ce qu’une marque et quel est son rôle ?
Selon l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), une marque est “un signe susceptible de représentation servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale”.
Une marque peut prendre plusieurs formes. Il peut s’agir :
- d’un mot ou un nom (par exemple, « Nespresso ») ;
- d’un logo (par exemple, une pomme stylisée pour une marque d’électronique) ;
- d’un slogan (par exemple, « Parce que vous le valez bien ») ;
- d’une couleur spécifique (comme le rouge d’une semelle de chaussures haut de gamme) ;
- d’une forme tridimensionnelle (le contour d’une bouteille de parfum) ;
- voire d’un son (comme la petite mélodie d’un service de streaming) ou d’une odeur (sous certaines conditions).
Tous ces signes distinctifs ont en commun de permettre au consommateur d’identifier immédiatement l’origine d’un produit ou d’un service sur une page d’accueil, dans une fiche produit ou au sein d’un site marchand. C’est aussi un élément clé pour lui permettre de le distinguer de ceux des concurrents.
Quels sont les droits acquis suite au dépôt et à l’enregistrement d’une marque ?
L’enregistrement d’une marque vous donne un droit exclusif sur le signe choisi. En France, ce droit s’acquiert par un dépôt auprès de l’INPI (CPI, art. L712-1). Au niveau européen, c’est l’EUIPO qui délivre une protection valable dans l’ensemble de l’Union européenne. À l’international, le système de Madrid géré par l’OMPI permet d’étendre plus facilement cette protection à plusieurs pays.
Ce droit exclusif (monopole) vous permet de décider qui est autorisé ou non à exploiter votre signe distinctif et sous quelles conditions. Vous pouvez donc accorder des licences à des tiers, céder votre marque ou agir devant les tribunaux en contrefaçon en cas de copie identique ou similaire à l’origine d’un risque de confusion. Enfin, une marque déposée vous autorise à faire opposition à une autre marque postérieure, lors de sa publication au Bulletin officiel.
Bon à savoir : en France, la durée de protection est de 10 ans à compter de la date de dépôt, renouvelable indéfiniment (CPI, art. L712-2).
Marque et e-commerce : quels sont les enjeux ?
Par définition, le commerce en ligne n’a pas de frontière. Cette réalité rend la protection de votre marque beaucoup plus complexe que dans le cadre d’un commerce physique. Très vite, vous devrez vous poser des questions juridiques déterminantes : quelle est la loi applicable si un litige éclate ? Quel tribunal sera compétent ? Quelle jurisprudence prévaut dans les pays où vous vendez ? Autant de problématiques qui nécessitent l’accompagnement d’un avocat en droit des marques.
Par ailleurs, les problématiques liées à votre marque ne concernent pas uniquement la création de votre site internet et votre nom de domaine. Elles concernent l’ensemble de votre stratégie digitale et s’étendent aussi aux réseaux sociaux et aux marketplaces, devenus des canaux incontournables pour développer vos ventes. Or, sur ces espaces, les atteintes aux marques sont fréquentes : contrefaçons, faux comptes, publicités trompeuses, etc. Ces pratiques peuvent détourner votre clientèle et nuire à votre réputation en ligne.
Enfin, gardez à l’esprit que la vigilance va dans les deux sens. Vous devez protéger votre propre marque, mais aussi veiller à ne pas enfreindre les droits des autres. Une campagne AdWords utilisant la marque d’un concurrent, par exemple, peut suffire à déclencher une action en justice.
Marque et e-commerce : quels sont les risques juridiques
Risque n°1 : utiliser une marque déjà protégée
Le risque et ses conséquences pour votre business
En matière de marque, gardez en tête que sans dépôt, pas de droit. Si vous lancez une boutique en ligne sur WordPress, PrestaShop, Shopify ou Magento, que vous investissez dans le référencement et dans la création de sites e-commerce, mais que votre marque n’est pas déposée, vous prenez un risque majeur : perdre l’ensemble de vos investissements.
En pratique, cela signifie qu’un concurrent ou un titulaire de droits antérieurs peut vous adresser une mise en demeure et obtenir le retrait de votre nom de domaine, de votre site e-commerce et de vos comptes sur les réseaux sociaux. Vous pourriez également être contraint de procéder à une refonte complète de votre projet digital (nouveau nom, nouveau logo, nouveau domaine), avec à la clé des coûts financiers et une perte de visibilité considérable.
Les bonnes pratiques pour limiter ce risque
- Choisissez un signe distinctif pour votre marque.
- Sélectionnez les classes adaptées à vos activités actuelles, mais aussi à vos projets pour les 12 à 24 prochains mois.
- Effectuez une recherche d’antériorité approfondie, avant tout dépôt, en interrogeant les bases de données de l’INPI (France), de l’EUIPO (Union européenne) et de l’OMPI (système de Madrid pour l’international). Effectuez une veille sur les moteurs de recherche, les marketplaces et les réseaux sociaux afin de repérer d’éventuels usages concurrents, même non enregistrés.
- Pensez également à la dimension territoriale de votre marque. Un dépôt national suffit si vous vendez uniquement en France (et que vous n’avez pas l’intention d’étendre votre business à l’étranger). Pour une protection plus large, vous pouvez optez pour un dépôt européen ou international via l’OMPI.
Risque n°2 : voir sa marque contrefaite
Le risque et ses conséquences pour votre activité web
Le commerce par internet est un terrain propice à la contrefaçon. Vos produits peuvent être copiés et revendus sur des sites e-commerce frauduleux ou des marketplaces (Amazon, eBay, Vinted). Vos logos peuvent être reproduits sur des sites frauduleux pour détourner votre clientèle. Il existe aussi un risque que votre marque soit exploitée abusivement dans le cadre du dropshipping.
Pour en savoir plus, consultez notre article sur la contrefaçon et les sites e-commerce.
Les conséquences pour votre business sont lourdes :
- réduction du retour sur investissement des actions digitales ;
- perte de chiffre d’affaires : vos clients potentiels se tournent vers des copies, souvent vendues à bas prix ;
- atteinte à votre réputation : un consommateur qui achète un faux produit de mauvaise qualité l’associera malgré tout à votre marque ;
- affaiblissement de votre référencement naturel : les contrefacteurs peuvent détourner le trafic de votre site web en reprenant vos signes distinctifs dans leurs contenus et leurs annonces en ligne.
Les bonnes pratiques à mettre en place pour protéger votre marque en ligne
- Mettez en place une surveillance de marque à 360° en utilisant des outils de veille spécialisés pour suivre les marques et les noms de domaine proches de votre signe distinctif. Activez des alertes Google pour repérer des utilisations suspectes et surveillez régulièrement les marketplaces et réseaux sociaux. Les agences digitales et les cabinets d’avocats proposent des services clés en main.
- Préparez à l’avance une procédure standardisée pour signaler une contrefaçon. Sur les marketplaces, cela prend la forme de formulaires de notice and takedown (Amazon Brand Registry, eBay VeRO, etc.). Sur les réseaux sociaux, utilisez les outils de signalement prévus. En cas de site web frauduleux, contactez l’hébergeur ou le registrar.
- Réagissez rapidement ! Plus une contrefaçon reste en ligne longtemps, plus elle cause des dégâts. Un retrait le plus tôt possible limite l’ampleur des dommages et évite que vos investissements en marketing digital (SEO, campagnes Ads, création de contenu) ne soient compromis par la prolifération de copies.
- Faites appel à un avocat en droit des marques pour vous accompagner dans les différentes actions pour protéger votre marque sur Internet.
Consultez notre guide complet pour savoir comment protéger la marque de son site internet.
Risque n°3 : enfreindre les droits de marques tierces
Le risque et ses conséquences pour votre projet digital
En e-commerce, il arrive qu’un e-commerçant, volontairement ou non, utilise un signe déjà protégé par un tiers. Cela peut concerner le nom choisi pour votre boutique en ligne, l’usage d’une marque concurrente dans vos contenus SEO ou encore l’intégration d’un logo ou d’un slogan qui ressemble de trop près à celui d’un acteur déjà en place.
Même sans intention frauduleuse, ces usages peuvent être qualifiés de contrefaçon ou de concurrence déloyale.
- L’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) interdit expressément l’usage d’une marque postérieure susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public avec une marque antérieure.
- L’article 1240 du Code civil permet en outre à une entreprise lésée d’agir pour faute, dès lors qu’un dommage est causé (perte de clientèle, atteinte à l’image).
Intégrer la marque d’un concurrent dans vos balises SEO ou dans une campagne Google Ads, de manière à laisser croire à un partenariat officiel, constitue une pratique trompeuse. Elle peut être sanctionnée comme de la concurrence déloyale.
Les conséquences pour un e-commerçant sont sérieuses : mise en demeure, retrait des contenus litigieux, suspension de campagnes publicitaires, voire dommages et intérêts importants. Un tel litige entraîne aussi une perte de confiance auprès des clients et des partenaires commerciaux.
Les bonnes pratiques pour limiter ce risque
- Nous ne le répéterons jamais assez : vérifiez systématiquement l’existence de droits antérieurs, avant de créer votre site ou de lancer une campagne publicitaire. Pour cela, consultez les bases de données officielles et sur Internet.
- Évitez toute confusion dans votre communication digitale. Ne supposez pas un lien économique inexistant avec une autre marque. Bannissez les formulations ambiguës comme “partenaire officiel” ou l’utilisation de logos concurrents.
- Soyez vigilant en SEO et SEA. En référencement naturel, privilégiez les mots clés génériques ou descriptifs (« chaussures running homme ») plutôt que les marques concurrentes. En référencement payant (Google Ads), l’enchère sur un mot-clé de marque peut-être admise. Vos annonces et vos pages de destination doivent toutefois rester objectives et ne pas suggérer de partenariat.
- Avant chaque lancement de produit, de campagne ou de site, vérifiez que vos choix graphiques et vos mots-clés ne portent pas atteinte aux droits d’autrui.
Risque n°4 : cybersquatting et usurpations numériques
Le risque et ses conséquences pour votre boutique en ligne
Votre nom de domaine et vos comptes sur les réseaux sociaux sont des prolongements directs de votre marque. Or, ces actifs immatériels sont particulièrement exposés à des pratiques frauduleuses et notamment :
- au cybersquatting : un tiers enregistre volontairement un nom de domaine identique ou proche du vôtre pour tirer profit de votre notoriété ;
- au typosquatting : même logique, mais en jouant cette fois sur les fautes de frappe (“amazn.com” ou “ventprivee.fr”, par exemple) ;
- à une usurpation d’identité sur les réseaux sociaux : faux comptes se présentant comme votre service client, par exemple.
Les conséquences pour votre activité e-commerce sont multiples :
- perte de trafic : les internautes se trompent d’adresse et arrivent sur un site concurrent ou frauduleux ;
- confusion pour vos clients qui peuvent croire interagir avec vous alors qu’ils tombent sur un imposteur ;
- atteinte directe à votre réputation : faux SAV, faux produits, arnaques associées à votre marque, etc.
Les bonnes pratiques pour protéger votre commerce en ligne
- Avant de réserver votre domaine, assurez-vous qu’il ne porte pas atteinte à une marque existante.
- Sécurisez au minimum le .fr et le .com. Si vous avez une ambition internationale, pensez aussi au .eu, .net ou encore aux extensions locales (.de, .es, etc.). Cette stratégie défensive empêche des tiers d’occuper le terrain.
- Sécurisez vos identifiants sociaux sur les principales plateformes (Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter/X), même si vous ne les utilisez pas immédiatement.
- Mettez en place une veille active en configurant des alertes sur votre marque afin d’agir vite.
- En cas de problème, agissez sans tarder en utilisant les procédures extrajudiciaires. Signalez le problème aux plateformes et faites intervenir votre avocat avec une mise en demeure.
Pour protéger efficacement une marque en e-commerce, il ne suffit pas de réagir aux problèmes quand ils surviennent. La meilleure solution est de mettre en place une stratégie à 360° : dépôt anticipé de la marque, veille active de son utilisation en ligne, anticipation des litiges et accompagnement par des experts comme Infolawyers.
Les questions fréquentes sur les marques et le e-commerce
Puis-je acheter la marque d’un concurrent comme mot-clé dans Google Ads ?
Oui, c’est possible, mais de manière très limitée. Comme le rappelle la jurisprudence européenne (CJUE, Google France, 23 mars 2010), l’internaute doit, sans aucune ambiguïté, savoir que les produits ou les services visés par l’annonce proviennent d’un tiers.
Que faire si mon nom de domaine est squatté par un tiers ?
Vous devez constituer un dossier comprenant votre titre de marque, des captures horodatées de vos pages, etc. Cela vous permettra d’engager une procédure extrajudiciaire auprès du registrar pour obtenir le transfert du domaine (UDRP). Cette voie est souvent plus rapide et moins coûteuse qu’un procès classique.
Puis-je citer une marque tierce dans mes fiches produits ?
Oui, mais uniquement si cela est nécessaire pour informer vos clients (par exemple, “housse compatible avec iPhone”). Veillez toutefois à rester neutre et à ne pas utiliser le logo ou la charte graphique d’une autre entreprise, car cela pourrait créer une confusion et engager votre responsabilité.
Suis-je responsable en cas de contrefaçon en dropshipping ?
Absolument, car pour le consommateur, vous êtes le vendeur du produit, même si la contrefaçon a été réalisée par votre fournisseur. Vous pouvez donc être attaqué en justice si le produit est contrefait ou non conforme. D’où l’importance de choisir des fournisseurs fiables et de conserver toutes les factures et les preuves d’authenticité des produits.
Comment surveiller efficacement ma marque en ligne ?
Vous pouvez mettre en place des alertes automatiques (Google Alerts, outils spécialisés). Pensez également à surveiller les marketplaces et les réseaux sociaux. Pour plus d’efficacité, il est préférable de confier cette mission à un cabinet d’avocats spécialisé.